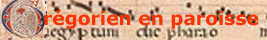Nous avons reçu, ô Dieu, ta miséricorde au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ainsi ta louange couvre l'étendue de la terre, ta droite est remplie de justice. Le Seigneur est grand et digne de toute louange, dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte ». (Psaume 47, 10, 11, 2)
Dom Gajard définit d'un mot le caractère musical de ce chant d'entrée en le qualifiant ainsi : « C'est d'abord un merci à Dieu de tout ce qu'il a fait pour l'humanité... mais un merci joyeux, affectueux, filial : tout y est naturel, simple, allant, gracieux, au début du moins. Ce n'est pas l'action de grâces solennelle ; on est joyeux, on se sent aimé, et on chante, voilà tout. ».
C'est l'interprétation de toute la première phrase. Il s'agit d'un 1er mode, le mode de la paix, et cela se sent d'emblée, dès l'intonation qui est typique et qui fait penser à l'introït Gaudeamus ou à l'offertoire Jubilate. Le mot misericordiam est doucement enveloppé, avec un accent bien mis en valeur par le double DO aigu. Tout est léger, sans qu'on ait besoin de forcer aucunement les voix. Le tempo est soutenu par l'élan d'un paisible enthousiasme. Aucun excès, mais de la légèreté, partout.
Avec la deuxième phrase, l'atmosphère change. On est d'ailleurs passé d'un verbe au passé simple (suscepimus : nous avons reçu) à une phrase au présent. De plus on est passé de l'action de grâces à la louange. Enfin, on est passé d'un verbe à la première personne du pluriel (nous) à un verbe à la troisième personne du singulier. Il ne s'agit plus de nous qui avons reçu la grâce et l'amour de Dieu, mais de Dieu lui-même. Pour toutes ces raisons, amplement suffisantes, un changement très net se fait sentir.
Au plan strictement mélodique, c'est déjà bien visible : la mélodie de la première phrase se campait autour du LA, surtout et du FA. Elle touchait quelquefois le DO, plus par manière d'annonce d'ailleurs.
Avec la deuxième phrase, le DO aigu devient clairement la note dominante, attractive, le LA n'étant plus qu'une note d'appui ou de retombée. En outre, les neumes très légers de la première phrase ont laissé la place à des neumes plus larges, et dom Gajard remarque que c'est vrai dans toutes les familles de manuscrits. L'humble merci a fait place à la grande louange. Et le chant s'envole et s'étoffe. Le sommet de la pièce est atteint sur le mot nomen, au tout début de la deuxième phrase. Jusqu'au bout on va rester dans la contemplation de ce nom bien aimé. L'âme, l’Église, est fixée sur les hauteurs, elle regarde et elle aime, dans une sorte d'extase de louange. Oublieuse d'elle-même, du bienfait qu'elle a reçu, elle se donne. Et dom Gajard remarque très profondément que ce passage de la simple contemplation à la grande louange admirative est caractéristique de ce qu'il appelle la méthode d'oraison de l’Église. C'est très juste, cela.
Dans la liturgie, l’Église se manifeste vraiment comme une maîtresse d'oraison. Mais on peut dire qu'elle n'enseigne pas l'oraison, elle la vit.
Très souvent, dans les pièces grégoriennes, on la voit se mettre en oraison en commençant par méditer simplement, par exemple un attribut divin qui la concerne (ici la miséricorde). Et puis, de façon plus ou moins soudaine, on pourrait dire selon la violence de l'Esprit qui la ravit comme de force, elle est emportée dans sa contemplation et elle éclate en une louange qu'elle ne semble plus maîtriser. Elle est toute entière alors sous l'influence de l'Esprit qui joue en elle comme sur une lyre et lui fait rendre les sons c'est-à-dire les sentiments les plus divins. C'est peut-être là que réside surtout le génie spirituel de l'art grégorien, ce qui fait son incomparable supériorité par rapport aux autres répertoires de musique sacrée. On peut penser que ses compositeurs n'étaient pas seulement des artistes mais aussi et surtout des saints et même des mystiques, des âmes d'oraison qui vivaient profondément les mystères du Christ, et qui se laissaient inspirer par eux au sens le plus fort, vraiment.
On peut revenir à notre chant d'entrée pour conclure. La pièce se termine en revenant au grave, non pas dans l'atmosphère joyeuse du début, mais dans une paix solide. Ça aussi c'est une des grâces du chant grégorien. Il finit toujours dans un mouvement intérieur, il recueille en plénitude le fruit de sa contemplation, il fait éprouver le sentiment ultime du salut qui est la paix, la paix après le combat, la paix qui ne finit pas, la paix qui est vie profonde et immense comme l'éternité. Cette mélodie qui s'apaise et qui revient sagement au RE, finale du 1er mode, évoque la plongée de l'âme dans l'océan de paix qui est Dieu. Ici, le dernier mot, c'est la main de Dieu, cette main pleine de justice et de miséricorde, cette main paternelle et vivifiante dans laquelle il fait si bon se réfugier. (Lire l'article complet)
Retrouver les enregistrement MP3 de cette messe ici >>>
Et les lecture de la messe ici >>>